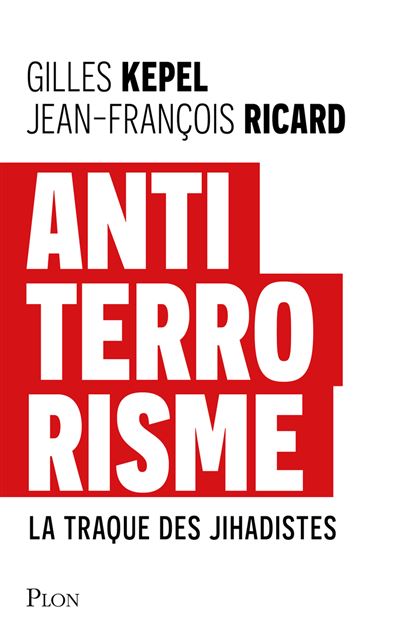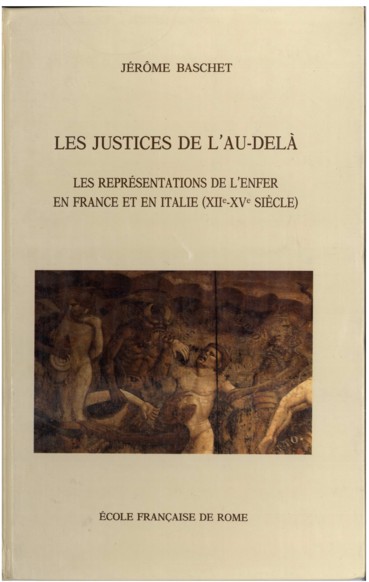Depuis trente ans, la France a subi des attentats de terroristes islamistes sur son sol, entraînant une réorganisation des services judiciaires et un approfondissement de la recherche universitaire. L’ancien procureur national antiterroriste Jean-François Ricard et l’islamologue Gilles Kepel retracent ces décennies mouvementées, mêlant leurs expériences et connaissances. Un ouvrage instructif qui nous fait découvrir comment furent traqués les djihadistes, que les défis et réflexions auxquels nous confronte le terrorisme islamiste.
Le « djihadisme d’atmosphère », expression créée à partir de l’expression des « atmosphères de la politique » du sociologue Bruno Latour, reste un grand problème. Dans cette nouvelle modalité du terrorisme, les attentats sont perpétrés par des individus qui ne répondent pas à des donneurs d’ordre mais qui sont formatés, notamment par les réseaux sociaux. Ces derniers ont détruit le raisonnement discursif puisqu’ils procèdent par collage d’éléments qui vont tous dans le même sens et conduisent à l’action. La violence terroriste passe désormais par la force de persuasion des réseaux sociaux, ce qui pose un problème majeur.
En Europe, « le drapeau palestinien est devenu une sorte de bannière générale pour ceux qui s’estiment victimes de toutes sortes de discriminations ». Le conflit israélo-palestinien a exacerbé les tensions sociales en Europe, qu’elle a recodé en termes identitaires. On le constate dans des manifestations qui n’ont rien à voir avec la Palestine, mais où le drapeau palestinien est devenu une sorte de bannière générale pour ceux qui s’estiment victimes de toutes sortes de discriminations.
Cet ouvrage est coécrit avec Jean-François Ricard, ancien juge d’instruction à la section antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris puis ancien procureur du PNAT. Nous avons écrit un livre à quatre mains qui conjuguent le savoir de l’universitaire, du professeur, à l’expérience du juge. Je me suis emparé de la question du terrorisme dès le début de ma carrière, lorsque je fus témoin de l’assassinat de Sadate en Égypte. J’ai ensuite étudié de près les organisations terroristes par l’étude de textes, la connaissance de la langue arabe et des voyages au Moyen-Orient. Mais il manquait à mon étude l’accès à ceux qui commettaient les attentats.
L’institution judiciaire, elle, a pu analyser les faits sur la base des déclarations des terroristes arrêtés, immersion de première main dans le phénomène du terrorisme, mais il lui manquait toute la compréhension du contexte apporté par les sciences sociales. Nos approches, avec Jean-François Ricard, ont donc été complémentaires. Nous avons ainsi essayé de mettre ensemble les pièces d’un puzzle.
Cet ouvrage contient un certain nombre d’informations que je ne connaissais pas et qu’a apportées Jean-FFrançois Ricard, notamment lors des attentats des années 2000. La mise en commun de nos connaissances a permis l’écriture d’une histoire assez complète du terrorisme de ces trente dernières années et de tâcher d’en tirer les leçons pour aujourd’hui. C’est une sorte de roman policier qui permet de suivre terroristes et enquêtes.
Les organisations djihadistes ont en commun l’allégeance à la doctrine islamiste, une référence littérale au texte sacré pour invoquer la licéité de leurs méfaits.
Qu’est-ce qui vous a le plus marqué au cours de l’écriture de cet ouvrage ? J’ai été frappé par le tournant des années 2000. Si j’avais identifié un certain nombre de mutations dans le terrorisme, notamment via la littérature spécialisée des islamistes, il était difficile de comprendre comment on passait du fonctionnement pyramidal d’Al-Qaïda au djihadisme qui allait ensuite toucher l’Europe. Même si j’avais lu les textes théoriques, notamment d’Abou Moussab al-Souri qui préconisait un djihadisme en rhizome, il me manquait la matière concrète, c’est-à-dire le suivi des individus qui avaient fonctionné comme ça. La mise en commun de nos connaissances a été particulièrement éclairante sur ces mutations-là.
Qu’ont en commun les organisations djihadistes de ces trente dernières années ? Toutes ont en commun l’allégeance à la doctrine islamiste, une référence littérale au texte sacré pour invoquer la licéité de leurs méfaits. Cela leur donne une forme de légitimité, même si la majorité des musulmans sont en désaccord avec cette approche. Cette légitimation religieuse est un argument très fort pour ne pas apparaître comme des criminels, mais comme des héros, des résistants. C’est toute l’ambiguïté du phénomène.
Votre livre montre aussi que, contrairement à nous, les terroristes ont une notion du temps long… Quelles conséquences ? C’est effectivement très frappant. Nous avons pu le constater grâce aux échanges qu’a eus Jean-François Ricard, quand il était juge d’instruction, avec des terroristes. Il rapporte que l’un d’entre eux lui avait demandé pourquoi il se fatiguait avec toutes ses questions. Eux avaient tout le temps car ils avaient Dieu avec eux. Cela pose alors le problème de la sanction pénale. Celle-ci, avec cette optique, a très peu de chances d’aboutir à la déradicalisation de l’individu. Cela se traduit dans de nombreux cas par le fait que la prison devient un incubateur de terrorisme parmi les détenus de droit commun. Leurs codétenus radicalisés leur expliquent que leurs agissements ont été induits par la société des infidèles.
Un autre élément très intéressant de votre ouvrage est le nombre d’attentats déjoués ces dernières décennies… C’est en effet assez remarquable et cela souligne combien la lutte antiterroriste a fait des progrès considérables par rapport aux années 1990 où on ne savait même pas identifier l’adversaire. Désormais les filières sont reconnues et la surveillance s’est accrue. La technologie n’est pas uniquement au service des djihadistes, elle permet également à nos services de suivre les terroristes, voire de les intercepter. L’antiterrorisme a permis d’empêcher des attentats majeurs de se produire, comme ceux dits de Francfort I et II qui visaient le marché de Noël de Strasbourg et auraient pu faire des centaines de morts. Aujourd’hui, la circulation d’informations est plus forte et est éclairée par les travaux d’un certain nombre d’universitaires.
Quel est le plus grand défi qui nous attend aujourd’hui en matière de lutte contre le terrorisme ? L’un des plus grands, en lien avec le djihadisme d’atmosphère que je décrivais tout à l’heure, est le lien entre le monde numérique et le passage à l’acte spontané. Il s’agit d’arriver à repérer des individus qui ne sont pas des loups solitaires car ils sont socialisés, mais qui s’autorisent des passages à l’acte car ils ont le sentiment de contribuer à une juste cause. Ce sentiment est alimenté par la fin de la transmission de normes et de valeurs entre les générations, et par la désinhibition induite par le numérique, que ce soit dans la violence, la radicalisation ou la pornographie.
L’influence pernicieuse des réseaux sociaux est un grand défi dans une société française fragmentée par la crise du système politique avec l’effondrement des partis traditionnels et le pitoyable spectacle donné par la classe dirigeante. Une faille culturelle, identitaire et morale ne cesse de s’agrandir, et si nous ne la traitons pas, nous nous exposons à de grands dangers.
Antiterrorisme, la traque des jihadistes de Gilles Kepel et Jean-François Ricard, Plon, 384 pages, 21,90 €.