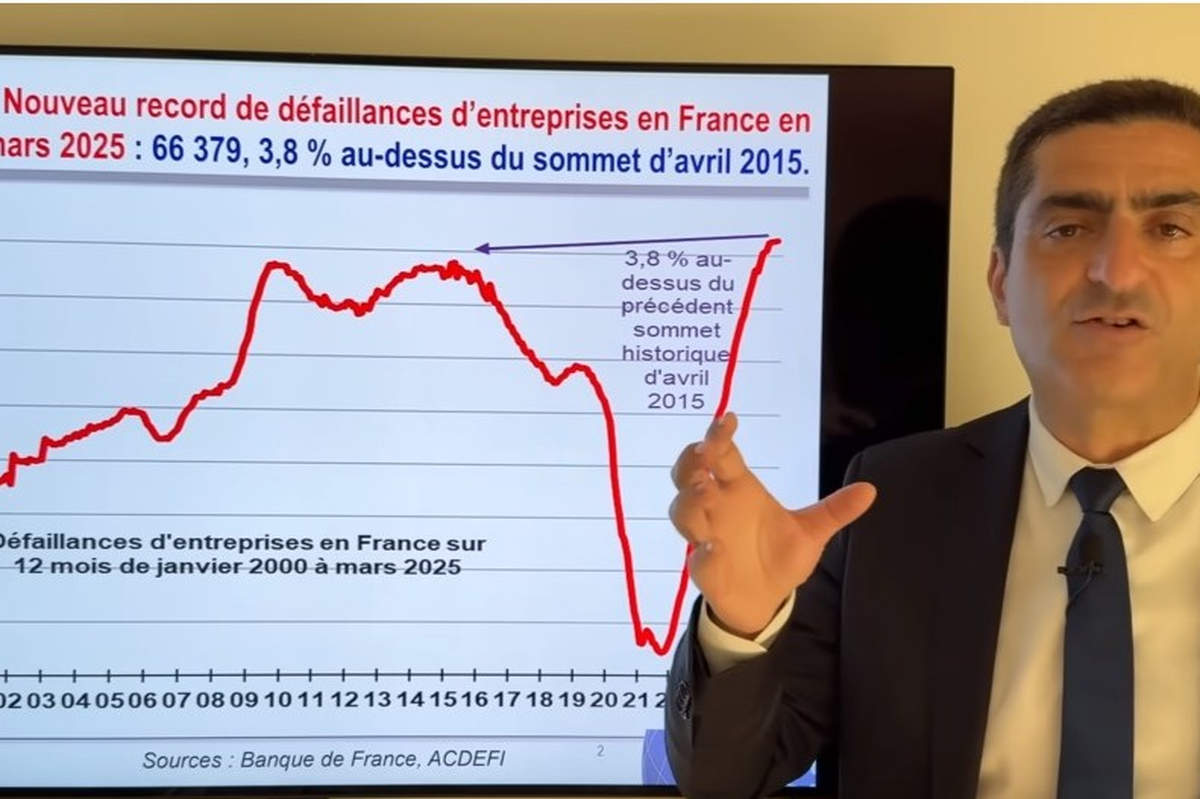Michéa, l’Amérique comme miroir de notre décadence
Dans Conversations américaines, le philosophe montpelliérain livre un diagnostic implacable sur la dérive du libéralisme et la déconnexion des élites progressistes, en France comme aux États-Unis.
Avec Conversations américaines (Albin Michel, 2025), Jean-Claude Michéa revient sur le devant de la scène intellectuelle, sans avoir jamais couru après les plateaux télé ni les salons parisiens. Fidèle à sa position de penseur en marge, il poursuit son exploration du libéralisme moderne et de ses effets dévastateurs sur les sociétés occidentales. L’ouvrage se présente comme un dialogue avec Michael C. Behrent, historien américain des idées, spécialiste de Michel Foucault. Ensemble, ils confrontent deux continents – et deux effondrements politiques parallèles : celui de la gauche américaine, et celui de la gauche française.
Le grand retournement : quand la gauche devient la gardienne du système
Au fil de ces échanges, Michéa décortique un phénomène qu’il observe depuis longtemps : la mutation des forces progressistes en courroies de transmission du capitalisme globalisé.
Aux États-Unis, le Parti démocrate s’est mué en parti des classes moyennes urbaines, diplômées et mondialisées, persuadées d’incarner le progrès et la morale. Pendant ce temps, les couches populaires – ouvriers, employés, ruraux – ont glissé vers un vote républicain, souvent incarné par la figure de Donald Trump.
Ce basculement n’est pas, pour Michéa, un accident, mais la conséquence logique du mariage entre le libéralisme économique et le libéralisme culturel : deux faces d’une même pièce qui dissolvent les solidarités, détruisent les appartenances et laissent derrière elles un monde d’individus isolés, livrés au marché et aux injonctions morales de la nouvelle bourgeoisie progressiste.
Le philosophe souligne d’ailleurs que ce renversement a d’abord eu lieu en Europe, avec la conversion de la gauche française au néolibéralisme sous Mitterrand. Le « consensus de Paris », comme l’appelle un chercheur américain cité dans le livre, aurait même précédé le « consensus de Washington ». Autrement dit, la gauche française a ouvert la voie à la gauche américaine, en adoptant dès les années 1980 les logiques financières et culturelles qu’elle prétendait combattre.
Du wokisme à la déconstruction : le libéralisme devenu fou
Michéa voit dans le wokisme, omniprésent aux États-Unis et désormais importé en Europe, le produit ultime de cette dérive.
Derrière son vernis moral et ses slogans pseudo-émancipateurs, il discerne une idéologie de classe, forgée dans les universités et les médias, qui flatte la bonne conscience d’une élite déconnectée. Cette élite parle au nom des « dominés » mais vit dans les quartiers les plus chers des métropoles mondialisées.
Le résultat, selon Michéa, est une société où la gauche ne défend plus le peuple, mais le marché, la technologie et les minorités de convenance, pendant que le monde populaire, lui, se replie sur le concret : travail, famille, territoire.
Ce libéralisme culturel, explique-t-il, n’est que le prolongement naturel du libéralisme économique : les deux reposent sur le même mythe de l’individu sans attaches, libre de choisir sa vie, sa morale et même son identité. La liberté n’y est plus enracinée dans le réel, mais dans l’illusion d’une autonomie totale – celle d’un être sans communauté, sans passé, sans héritage.
Michéa y voit la source d’une désintégration morale et anthropologique qui pousse l’Occident vers une forme de chaos civilisé : tout est permis, sauf la fidélité à ce qui a précédé.
Vers une « gauche conservatrice » ?
L’un des fils rouges du livre est la question d’un possible conservatisme de gauche, une idée que Michéa développe depuis longtemps.
Contre l’idéologie du progrès perpétuel, il plaide pour une gauche du commun, attachée à la décence ordinaire, à la vie locale, au travail bien fait, à la transmission.
Son modèle n’est ni celui du capitalisme de Silicon Valley, ni celui de l’État technocratique européen, mais celui d’un socialisme orwellien, fondé sur la solidarité des humbles et la méfiance envers les élites, qu’elles soient économiques ou culturelles.
Le philosophe dénonce la confusion mentale qui conduit la gauche à voir dans toute fidélité au passé une forme de réaction.
Pour lui, préserver ce qui fait tenir une société – les liens, les coutumes, les limites – n’est pas être réactionnaire, mais réaliste.
À l’inverse, croire que tout changement est forcément un progrès revient à se condamner à suivre le mouvement d’un monde sans boussole, où la technologie et la finance fixent désormais la loi du jour.
Michéa, le solitaire lucide
Conversations américaines n’est pas un livre académique. C’est un dialogue vivant, précis, parfois prophétique, où transparaît la fidélité de Michéa à Orwell, Lasch, Marx et Debord, autant d’auteurs qu’il réconcilie dans une critique commune du monde moderne.
Son écriture, toujours claire et mesurée, tranche avec les dogmes et le jargon universitaire.
On y retrouve le penseur rural qui préfère la bêche à l’ordinateur, la ferme à la métropole, le bon sens à la virtuosité technocratique.
En filigrane, il avertit : l’Occident est en train de se coloniser lui-même, détruisant ses propres cultures sous le prétexte de l’ouverture au monde. La « machine moderne », écrivait Stefan Zweig, uniformise tout. Michéa ne dit pas autre chose : ce n’est plus le monde qui se mondialise, c’est l’homme qui disparaît.
À l’heure où la politique se réduit à un jeu de communication, Conversations américaines agit comme un électrochoc.
Michéa y démontre que la crise de la gauche n’est pas un accident électoral, mais une faillite morale et intellectuelle.
Refusant le cynisme comme le fatalisme, il appelle à renouer avec une pensée du réel, enracinée, décente et populaire — celle qui pourrait, peut-être, refonder la civilisation européenne sur autre chose que la marchandise et le virtuel.
La décadence française à travers le miroir américain : un diagnostic implacable de Michéa